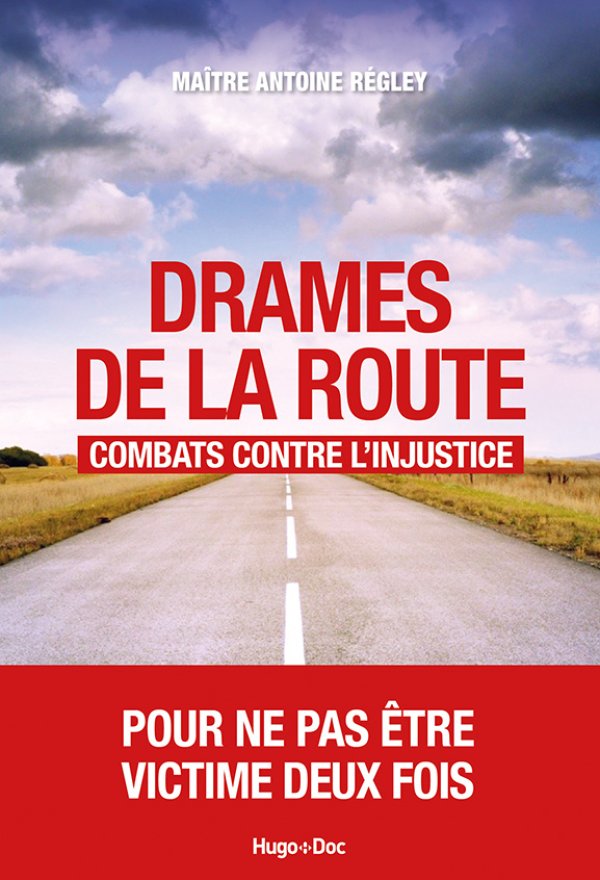Ces derniers mois (notamment avec l’affaire Palmade / les policiers de Roubaix) ou plus récemment ces dernières semaines (drames de la Rochelle, rodéo de Vallauris, etc.), l’actualité nous a encore apporté son lot d’événements dramatiques survenus sur la route à la suite de divers actes de délinquance routière. Et comme j’ai eu l’occasion de l’évoquer à plusieurs reprises sur différents médias, pendant ce temps-là, rien ne change. Même le projet de nouvelle loi instaurant le délit d’homicide routier n’a pas eu le temps d’aboutir, suspendu par la dissolution de l’Assemblée Nationale. Une suspension et une triste actualité qui nous amènent à la question suivante : et si on en profitait pour « vraiment » changer les choses ?

Homicide routier : et si on construisait ensemble autre chose qu’une coquille vide ?
Avoir voulu transformer l’homicide involontaire lors d’un accident de la route en homicide routier est une bonne idée. Pour les familles de victimes d’accidents mortels de la route, le terme « involontaire » est devenu insupportable. S’il existe de vrais « accidents » qui doivent leur malheureuse existence au destin, à la malchance ou à la maladresse, il ne peut être dit que l’accident causé par la vitesse, l’alcool, le téléphone ou les stupéfiants ne présente pas un côté volontaire. Certes, la mort n’est pas donnée de manière intentionnelle. Mais, le comportement à risque, lui, a été pris de manière consciente, sans pouvoir dire que le danger était ignoré. Ce ne sont pas des homicides volontaires (meurtres ou assassinats prévus par le code pénal). Ce ne sont pas, non plus, des actes totalement involontaires. Il fallait donc trouver un autre terme pour tenter d’apaiser les souffrances des victimes. Cela ressemble davantage à une infraction du code pénal, crime réprimé par la Cour d’Assises, que nous connaissons bien depuis le procès du chanteur Bertrand Cantat : les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La mort n’est pas voulue, mais le comportement violent à risque est assumé. C’est 15 ans de réclusion criminelle qui sont encourus.
Cependant, ce changement de mot – aussi nécessaire soit-il – ne suffit pas à effacer les plaies d’hier et prévenir les drames de demain. En réalité, cette « réformette » est un petit cadeau fait aux associations de victimes de la route – et au chef Alléno – qui le réclament depuis plusieurs années. C’est surtout une manière d’acheter leur silence pour que l’État n’accède pas aux vraies demandes de réformes faites par les victimes de la route et moi-même, dans le livre que nous avons écrit ensemble « Drames de la route : combats contre l’injustice » (Ed. Hugo Doc).
Comment montrer aux victimes d’accidents de la route, et aux victimes indirectes que sont leurs proches, que nous avons été à l’écoute de leur douleur en créant une loi d’homicide routier dont le changement sémantique est la seule chose qui diffère ? Ce n’est pas sérieux.
Des vraies réformes, nous, on en a des pages ! Avec les victimes et associations de victimes avec lesquelles je travaille – qui n’ont pas comme ambition de « rentrer des dossiers » mais de prévenir les drames de demain et être aux côtés des familles de ceux d’hier -, nous dénonçons la vacuité de cette loi que j’ai qualifié de « coquille vide » dès le mois de février 2023 sur le plateau de BFM et ailleurs, expression reprise en boucle depuis lors.
Demandez à la famille endeuillée par Pierre Palmade si cela change vraiment quelque chose pour elle ? Et la famille de la petite Kamilya, percutée à Vallauris par un motard qui faisait du rodéo urbain ? Et les policiers de Roubaix ? Et les enfants renversés à La Rochelle par une personne âgée ? Que leur donne-t-on qu’ils n’avaient pas avant ? Toujours des mots. Encore des mots. Toujours des mots. Les mêmes mots. Rien que des mots, aurait chanté Dalida.
Alors, pour répondre à cette loi qui trahit les espoirs des victimes, et qui ne leur accorde pas un droit supplémentaire, que faut-il faire ?
Il faut révolutionner la loi Badinter avec plusieurs ambitions, dans le seul intérêt des victimes : un meilleur accompagnement psychologique, une justice plus rapide et plus sévère, et une indemnisation plus facile.
Il faut cesser la politique de la communication et du symbole pour consacrer la politique de la considération des victimes de la route.
Peut-être, faut-il aussi agir contre la délinquance routière sous toutes ses formes.
Créer une nouvelle loi forte, considérant les victimes de la route
Avec une dose de superstition, on pourrait presque y apercevoir un signe. La suspension de la création de l’homicide routier avec la dissolution de l’Assemblée Nationale est une opportunité rêvée. Nous devons pouvoir reprendre cette loi, et enfin traiter les choses en profondeur, pour mieux prévenir les drames de demain, et respecter la douleur des victimes des accidents de la route et de leurs proches. Que l’on choisisse de garder ce projet de loi sous le nom d’homicide routier, ou que l’on en trouve encore un autre que le terme devenu inaudible d’homicide involontaire, il est impératif d’en profiter pour bâtir une loi qui soit enfin à la hauteur des attentes de toutes les victimes d’accidents routiers, valant pour les homicides ainsi que pour les blessures.
Quelles solutions pour combattre la délinquance routière ?
Augmenter les peines de prison est une piste lancée par certaines associations de victimes qui n’ont rien compris. Le plus souvent en matière de délinquance routière, le souci ne vient pas tant de la sévérité de la loi – encore que l’on peut en débattre – mais par le fait que les juges n’appliquent pas les peines prévues par le code de la route et le code pénal.
Aujourd’hui, un homicide involontaire « routier », c’est entre 5 ans et 10 ans de prison encourus selon les circonstances aggravantes. Combien de personnes poursuivies pour ces faits finissent en prison ? Moins de 10 %. Comment expliquer à des familles de victimes d’homicides routiers et d’homicides involontaires que la personne qui leur cause une souffrance perpétuelle, les enfermant à tout jamais dans une peine éternelle, ne connaisse jamais l’enfermement d’une prison, même quelques jours ? Parce qu’il n’y a pas de place dans les prisons… Est-ce cela la justice ? Comment ne pas comprendre ces citoyens qui ne croient plus en la justice, et qui s’en éloigne dangereusement. Quelle responsabilité aura la Justice lorsque, dégoûté d’une décision incompréhensible, le parent d’un enfant décédé sur la route ira se venger de l’auteur, se rendant justice seul ? Qui finira en prison ? Se rend-on compte de cette injustice ? Celui qui vengerait la mémoire de son enfant irait en prison quand celui qui lui a enlevé sa raison de vivre n’en fera jamais…
Dans « Drames de la route : combats contre l’injustice », je reprends la proposition de plusieurs victimes : celle de courtes peines de prison effectives. Les victimes ont ce petit quelque chose d’humanité que les autres n’ont pas. Si elles veulent voir l’auteur être en prison, elles pensent aux enfants de ce dernier. Elles savent ce que cela fait d’être privé de l’être aimé sans n’avoir rien demandé et sans l’avoir mérité. Alors, pour que ces personnes innocentes (les proches de l’auteur) ne soient pas injustement privées longtemps de leur proche, les victimes proposent que de courtes peines de prison puissent être prononcées. On fait court. Mais on fait ferme. Le choc du milieu carcéral doit permettre à des personnes de comprendre, ce que le bracelet électronique ou le sursis ne permet pas toujours.
Une autre idée retient mon intérêt en ce qu’elle prévient autant qu’elle répare : faire payer les dommages et intérêts par l’auteur.
Aujourd’hui, même dans les cas les plus graves d’homicides routiers ou blessures involontaires avec amputation, traumatisme crânien, tétraplégie ou paraplégie, les assurances payent les dommages et intérêts (nous verrons dans un autre article qu’elles font cependant tout pour se défausser) à la place de l’auteur qui, lui, n’a pas un euro à débourser ! On marche sur la tête, non ? Même quand il y a de l’alcool, de la vitesse ou des stupéfiants, l’auteur ne paye rien dès lors qu’il est assuré. C’est la déresponsabilisation totale.
Mais, si les auteurs n’ont pas peur d’une peine de prison qu’ils savent ne pas faire, pourraient-ils avoir peur d’être ruinés à vie ? Oui. Et s’ils n’en ont pas peur, nous pourrons compter sur les proches de l’auteur pour lui éviter de prendre un risque au volant afin de ne pas être ruinés avec lui !
Les conducteurs ont peur de l’aspect financier. Nous l’avons constaté avec les radars implantés depuis l’an 2000. La délinquance routière a beaucoup baissé.
Dès lors, quand vous savez que vous risquez d’avoir à payer des sommes à 6 ou 7 chiffres (il n’est pas rare que j’obtienne des millions d’euros pour mes clients), vous appréciez différemment le danger.
Concrètement, pour ne pas que la victime soit lésée, l’assurance payerait les dommages et intérêts, puis se retournerait contre l’auteur jusqu’au dernier euro.
Cette idée est très prometteuse. Elle a un très grand intérêt préventif et répressif. En outre, cette réforme – on est loin d’un petit changement de mot pour faire plaisir à quelques associations qui ont trahi – aura le soutien du lobby des assureurs, lobby très puissant !
Voilà deux pistes très intéressantes, peu compliquées à mettre en pratique. Le souci, c’est que le gouvernement choisit les associations avec lesquelles il discute de changements de lois. Et celles choisies sont très sages dans leurs demandes. Le manque d’ambition de quelques associations est criminel. Quand de vraies solutions peuvent éviter les drames, certains ne semblent pas avoir un réel intérêt à les appliquer, pour des raisons économiques bien obscures.
Victimes de la route : serons-nous un jour véritablement à leur écoute ?
Si les deux idées qui précèdent pourraient contribuer à améliorer l’arsenal dissuasif vis-à-vis des homicides et blessures involontaires dans les accidents qui résultent de délinquance routière, elles auraient en même temps un autre atout considérable. Elles prouveraient la volonté d’écouter – enfin et véritablement – les victimes, pour qui le seul changement sémantique d’homicide involontaire en homicide routier n’est bien évidemment pas un signal suffisant pour lutter efficacement contre les délinquants routiers.
Mais attention, la considération des victimes ne peut pas s’arrêter à cela !
S’il est nécessaire qu’un nouveau texte se penche sur la question des sanctions pour les auteurs, il est tout aussi nécessaire – si ce n’est plus – qu’il se penche sur les questions d’accompagnement pour les victimes !
En tant qu’avocat en défense des victimes d’accident de la route, confronté de près à leur détresse, et ayant écrit un livre qui leur est dédié, je continuerai de me battre pour que :
- Les victimes d’accidents de la route bénéficient d’un accompagnement psychologique. Quand vous apprenez que vous perdez un très proche ou que vous allez être amputé, ou devenir tétraplégique ou paraplégique, vous devez être épaulé. Quand votre vie s’écroule, l’État doit vous offrir immédiatement un soutien. Il existe des cellules psychologiques – et c’est normal – pour les attentats ou affaires graves dans les écoles. Pourquoi n’existe-t-il pas la même chose pour les cas les plus grave de blessures routières et homicides routiers ? Cela coûte quoi au psychologue et au psychiatre de permanence à l’hôpital, de descendre quelques étages et être là immédiatement ? Et après, pourquoi la solidarité nationale ne paierait pas plusieurs mois ou années de séances de psy aux proches ou à la victime ? Dans le livre « Drames de la route : combats contre l’injustice », les victimes racontent le moment où elles ont appris que leur vie basculait. Il est impossible de lire ces témoignages sans pleurer ou avoir le cœur serré. Et, immédiatement, on se demande pourquoi personne n’est là pour elles. Il y a deux ans, lorsque le chef Antoine Alléno a perdu la vie suite à un homicide routier, son père, Yannick Alléno, expliquait la détresse dans laquelle il s’était retrouvée – lui l’homme pourtant si fort – à l’hôpital. Une pièce froide. Un corps froid. Et personne pour vous accompagner. Alors, au lieu de changer les mots, si on se battait pour que ces personnes frappées par le désarroi puissent être accompagnées ? C’est l’un des axes de propositions que je formule dans mon livre, et dans les médias. Au soir de l’affaire Palmade, j’étais l’invité de BFM. Quand le plateau tentait d’expliquer qu’il fallait aider les personnes qui se droguaient, dépendantes qu’elles sont, une seule voix s’élevait pour demander que l’on accompagne les victimes. La mienne.
- Les victimes d’accidents de la route ne soient plus culpabilisées par les assurances dans le cadre de l’indemnisation. Demander une somme d’argent prévue par la loi n’est pas un scandale. Ce n’est pas une honte. Lorsque l’on est victime d’un accident de la circulation, on est en droit d’être indemnisé. Le souci vient de nombre d’assurances qui tentent de culpabiliser les victimes et les familles. Pour ce faire, elles utilisent la loi Badinter, texte de référence de l’indemnisation des victimes de la route, et particulièrement l’article 4 qui leur permet d’invoquer – dans certaines circonstances – la faute de la victime pour l’indemniser moins. Très souvent, les motards sont victimes de ces tentatives. L’assureur tente donc de donner moins d’indemnités à la victime en la culpabilisant. Le but est d’arriver à obtenir un pourcentage de responsabilité de la victime qui fera faire des économies très importantes à l’assurance. Si la victime est seule, ou mal accompagnée, elle se fait avoir. Elle est victime deux fois. Dans « Drames de la route : combats contre l’injustice », je propose une grande refonte de la loi Badinter pour rendre beaucoup plus difficile, voire impossible, cette culpabilisation. Je formule des propositions pour que cette faute soit bien plus compliquée à démontrer pour l’assureur et que la victime n’ait jamais moins que la moitié de son indemnisation en cas de faute importante (délit) ou 75 % ou 90 % en cas de contravention. Dans tous les cas, et alors que les barèmes d’indemnisation (Dintilhac ou Mornet) prennent une place prépondérante, il est nécessaire que nous puissions changer ce système afin que les victimes ne soient pas … victimes deux fois.
- La justice soit plus rapide. Le temps qui passe, sans réponse, sans procès, sans indemnisation, est un grain de sel quotidien dans une plaie déjà béante. Les victimes de la route se plaignent de la lenteur de la justice et des procédures d’indemnisation. Je propose plusieurs pistes de réforme pour que la justice passe plus vite, et que l’indemnisation soit accélérée. Ces pistes sont techniques. Je vous renvoie au livre si vous souhaitez les connaître. Vous pouvez l’acheter ici (lien)
J’aimerais conclure en recoupant le sujet de cet article avec l’actualité récente et en vous laissant sur cette réflexion. Tout le monde s’accordera à dire que nous venons de vivre, en France, des Jeux Paralympiques d’une intensité et d’une ferveur inédites. Personne ne disconviendra qu’il en émane un souhait unanime vers davantage d’inclusion des athlètes, mais aussi plus globalement des personnes, en situation de handicap. N’héritons-nous pas désormais de ce devoir de considération accrue vis-à-vis de toutes les personnes qui sont frappées par le handicap ? Sachant que cela représente près de 20000 personnes chaque année dans les accidents de la route, chacun aura saisi l’urgence.